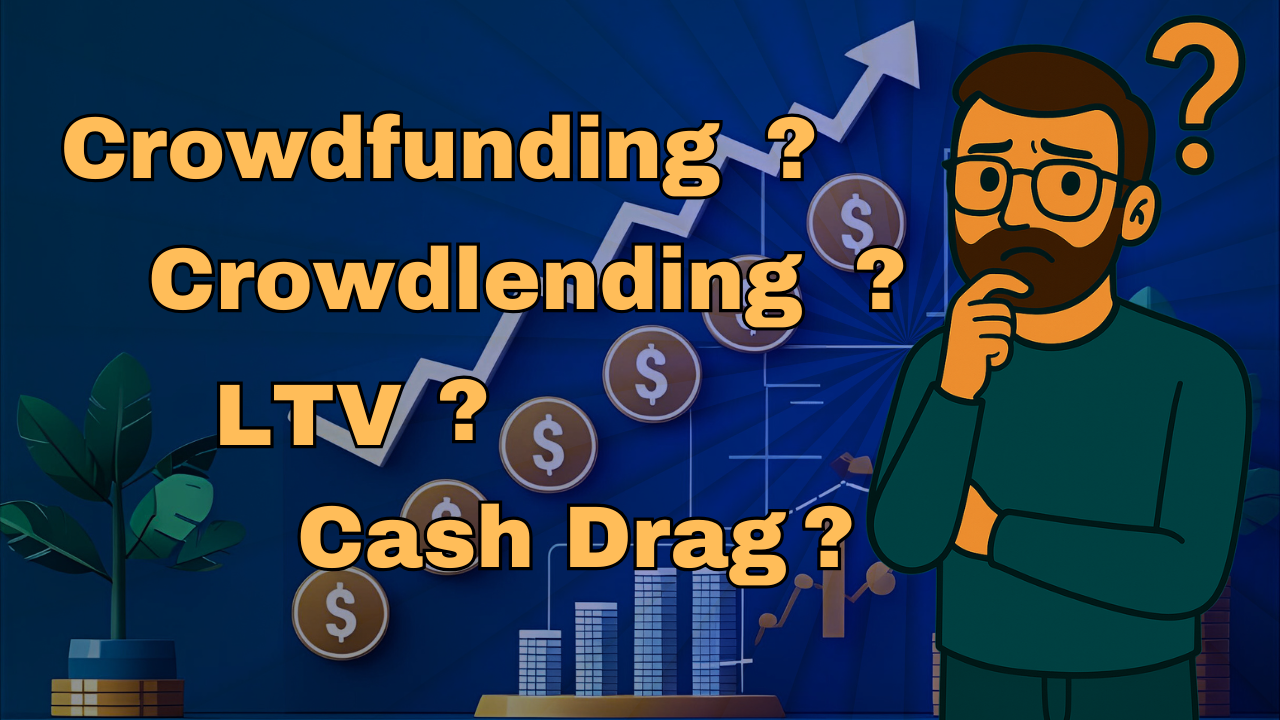Si vous froncez les sourcils quand vous lisez cash drag, LTA, LTV, buyback ou même affacturage, vous êtes exactement au bon endroit. Le financement participatif est devenu un vrai canal d’investissement pour les particuliers, mais il arrive souvent “en vrac” : beaucoup de plateformes, beaucoup de termes techniques… et pas toujours d’explications claires.
Dans cet article, on reprend tout depuis le début, avec un angle très concret : comment fonctionne le crowdfunding / crowdlending, quels sont les types de projets, quelles garanties existent, quels sont les vrais risques et quels indicateurs regarder avant d’investir.
Objectif : que vous soyez capable, à la fin, d’ouvrir une plateforme et de savoir si un projet vaut le coup.
1. Crowdfunding vs Crowdlending : la différence en 2 phrases
- Crowdfunding = financement participatif au sens large. On met en relation un porteur de projet qui cherche des fonds et une foule d’investisseurs particuliers. Ça peut être du don, de l’investissement en capital, de l’obligation… ou du prêt.
- Crowdlending = la partie “prêt” du crowdfunding. Vous prêtez de l’argent (à une entreprise, parfois à un particulier) via une plateforme, et vous recevez des intérêts en échange.
En français, on parle souvent de prêt participatif, de crowdlending ou de peer-to-peer lending.
Même si, sur cette chaîne et ce blog, on parle surtout de crowdlending et de crowdfunding immobilier, c’est utile de connaître le panorama :
- Le don : vous donnez, vous ne récupérez pas d’argent. Peu intéressant pour l’investisseur.
- Le prêt / crowdlending : vous prêtez, vous touchez des intérêts. C’est ce qu’on va détailler.
- L’investissement en capital / equity : vous entrez au capital d’une société. Potentiel de gain… mais risque plus fort et durée souvent plus longue.
- L’obligation / la dette : vous prêtez sous forme de titre financier. Vous touchez un coupon (intérêt) à une fréquence définie.
La plupart des gens qui veulent générer du rendement régulier sans gérer de locataires se retrouvent naturellement vers le crowdfunding immobilier, l’affacturage et le crowdlending d’entreprise.
3. Les types de projets que vous pouvez financer
C’est là que le financement participatif devient intéressant : vous pouvez prêter sur plein d’économies réelles différentes. Dans la pratique, on croise souvent :
- 🏗️ Crowdfunding immobilier : promotion, marchands de biens, refinancement.
- 🌱 Énergies renouvelables (ENR) : par ex. projets vus sur Enerfip, Lendopolis, Ventus Energy.
- 🚜 Crowdfunding agricole : parfois avec un collatéral (terrain, tracteur…), ce qui est rassurant.
- 💼 Affacturage / crowdfactoring : très utilisé par BienPrêter. Une entreprise a émis une facture mais sera payée plus tard → elle se refinance via la plateforme.
- 🚗 Prêts auto / conso / business : plutôt visibles sur les plateformes de crowdlending internationales (Mintos, Maclear, Afranga, etc.).
- 👤 Prêts personnels : l’équivalent du crédit conso, mais financé par des investisseurs.
👉 Cette diversité est un vrai atout : vous pouvez diversifier non seulement vos plateformes, mais aussi vos secteurs.
Un investissement en crowdfunding/crowdlending, c’est toujours le même triangle :
- Vous : l’investisseur qui apporte le capital.
- L’emprunteur / porteur de projet : l’entreprise (ou le promoteur) qui a besoin de fonds.
- La plateforme : l’intermédiaire qui sélectionne, met en ligne et suit les projets.
En France et en Europe, on voit souvent passer trois notions :
- AMF (Autorité des Marchés Financiers) et ACPR (Banque de France) : ce sont les régulateurs qui surveillent les plateformes françaises.
- PSFP (Prestataire de Services de Financement Participatif) : c’est l’agrément européen que les plateformes ont dû obtenir depuis 2023 pour pouvoir proposer des prêts, obligations, actions dans un cadre commun.
- ECSP / European Crowdfunding Service Provider : le nom anglophone de ce statut.
💡 Important : être réglementé ne veut pas dire “sans risque”. Certaines plateformes françaises agréées ont eu beaucoup de défauts en crowdfunding immobilier, alors que des plateformes de crowdlending étrangères (Pays baltes, Irlande…) tournent sans défaut depuis longtemps. Donc on ne se contente jamais du logo “agréé”, on regarde le reste.
5. Les acteurs “cachés” : loan originator, groupe, société de prêt
Sur les grosses plateformes internationales (Mintos, Lendermarket, Maclear…), vous voyez souvent passer les termes :
- Loan : c’est le prêt.
- Loan originator (LO) : c’est la société de prêt locale qui, elle, a analysé l’emprunteur. La plateforme, ensuite, met le prêt en vitrine.
- Groupe / holding : parfois, plusieurs sociétés de prêts appartiennent au même groupe. Ça compte, parce qu’en cas de pépin, c’est le groupe qui peut soutenir la filiale.
👉 Quand vous analysez, vous ne regardez pas seulement le projet, vous regardez aussi la santé de la société de prêt derrière. Bilan, chiffre d’affaires, bénéfices… ça se consulte très bien dans les rapports publiés ou dans la doc des plateformes.
6. Les risques à connaître avant de prêter
Le financement participatif n’est pas garanti. Les principaux risques :
- Perte en capital / défaut : le projet ne rembourse pas.
- Retard : fréquent en crowdfunding immobilier → votre argent est immobilisé plus longtemps.
- Risque de liquidité : si le projet dure plus longtemps que prévu et qu’il n’y a pas de marché secondaire, vous ne pouvez pas sortir.
- Risque opérationnel : retard de travaux, artisan défaillant, permis refusé, etc.
- Risque plateforme / société de prêt : la plateforme elle-même peut avoir des difficultés (on a déjà vu des gestions “extinctives” très longues).
- Risque géopolitique / devise : si vous prêtez en dehors de la zone euro.
➡️ D’où l’importance d’investir peu au début, de diversifier les plateformes et de surveiller les bilans financiers quand ils sont disponibles.
7. Les garanties : ce qui protège (un peu) votre capital
On ne peut pas parler de crowdfunding sans parler de garantie. On en rencontre plusieurs :
- Hypothèque (1er rang > 2e rang) : si le projet fait défaut, le bien peut être vendu.
- Fiducie / fiducie-sûreté : encore plus protectrice, plus rapide que la voie judiciaire.
- Collatéral : un actif réel (terrain, matériel agricole…).
- GAPD / Garantie à première demande : moins premium, utile seulement si la société est en bonne santé.
- Caution personnelle : complément mais pas magique.
- Délégation de paiement : très utilisée en affacturage (le client final paie la plateforme).
- Buyback (plutôt crowdlending international) : si l’emprunteur ne paie pas, la société de prêt vous rembourse après X jours (30, 60…).
👉 Regardez toujours la couverture : si on prête 500 000 € sur un terrain qui en vaut 500 000 €, c’est cohérent. Si on prête plus que la valeur réelle, le risque augmente.
8. Les chiffres et ratios qu’il faut maîtriser
C’est la partie qui fait peur dans la vidéo… alors on la met au clair.
8.1. LTV / LTS / Loan to Value
C’est le montant du prêt ÷ valeur de revente estimée.
- LTV < 60 % : très protecteur.
- LTV > 70 % : à regarder de plus près.
8.2. LTA / Loan to Acquisition
Montant du prêt ÷ prix d’achat du foncier.
Moins c’est élevé, plus vous êtes couvert.
8.3. LTC / Loan to Cost
Montant du prêt ÷ coût global du projet (achat + travaux + frais).
Intéressant pour voir si le porteur met des fonds propres.
Toutes les plateformes ne versent pas de la même manière :
- Intérêts mensuels, capital remboursé à la fin (in fine) : vous touchez juste les intérêts tous les mois, vous récupérez tout le capital à la fin.
- Mensuel avec amortissement : chaque mois vous touchez intérêts + un bout de capital (comme un crédit immo, mais à l’envers).
- Tout à la fin (capital + intérêts) : le moins intéressant pour générer du cash-flow.
- Annuel / trimestriel : plus rare, qu’on voit sur certains projets ENR.
- Intérêts réinvestis automatiquement : certaines plateformes permettent de faire de l’intérêt composé.
Le rendement affiché est souvent de 10 à 15 %, parfois 20 % sur certaines plateformes de crowdlending… mais il faut regarder le rendement réel.
- TRI / IRR : le taux de rendement interne réel, qui tient compte des dates de remboursement.
- XIRR : même idée, mais au plus près de la réalité de vos flux. Certaines plateformes l’affichent, c’est très pratique.
- Cash drag : c’est l’argent qui dort sur la plateforme parce qu’il n’y a pas assez de projets. Plus il est élevé, plus votre rendement réel baisse.
- Auto-invest : le robot d’investissement. Très pratique pour éviter le cash drag, à condition de bien régler les critères (taux, durée, pays, type de garantie…).
- Cashback / bonus d’inscription : c’est la cerise sur le gâteau. Ça booste le rendement, mais on ne choisit jamais une plateforme uniquement pour ça.
11. Marché primaire vs marché secondaire
- Marché primaire : le projet vient d’être mis en ligne, tout le monde peut investir.
- Marché secondaire : vous revendez votre prêt à un autre investisseur. Très utile pour récupérer de la liquidité plus tôt. Pas disponible partout (plutôt présent en crowdlending qu’en crowdfunding immobilier).
12. Bonnes pratiques pour bien démarrer
- Commencez petit : ticket de 10, 20 ou 50 € quand la plateforme le permet.
- Multipliez les projets plutôt que de mettre 1 000 € sur un seul.
- Regardez les garanties : hypothèque > promesse d’hypothèque.
- Regardez le pays / la devise : pas le même risque entre la France, la Croatie et l’Indonésie.
- Suivez vos retards : pour ne pas vous faire piéger sur la liquidité.
- Notez vos investissements dans un tableur (ou dans votre espace Notion) pour comparer votre rendement réel avec le rendement annoncé.
13. Et maintenant ?
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez :
- passer en revue vos plateformes de crowdlending / crowdfunding actuelles et vérifier garanties + LTV ;
- profiter des tickets bas (5 à 50 €) pour tester plusieurs modèles (immobilier, affacturage, ENR) ;
- et consulter votre page “partenaires et bons plans” pour voir les plateformes qui offrent un bonus d’entrée ou du cashback.